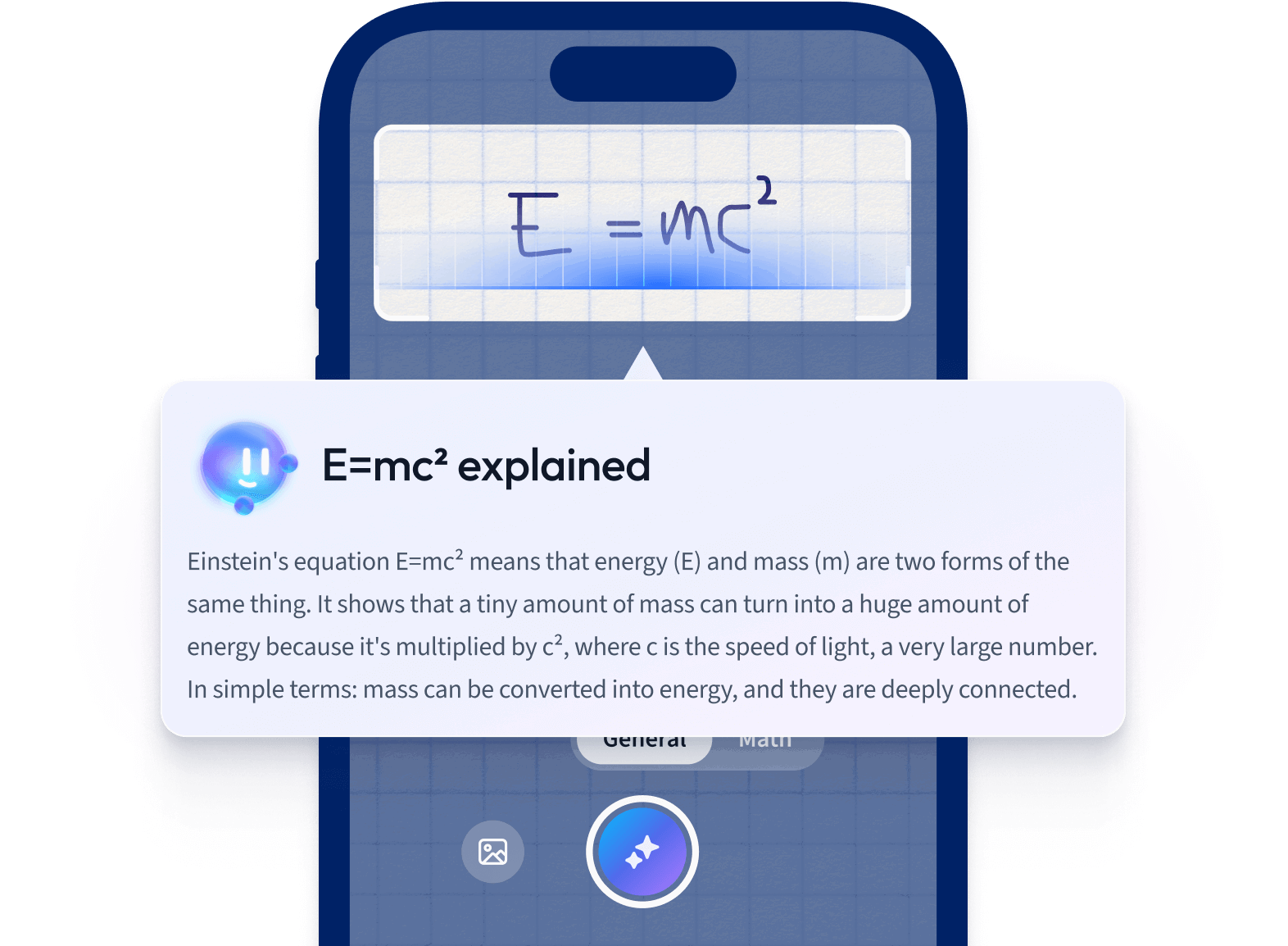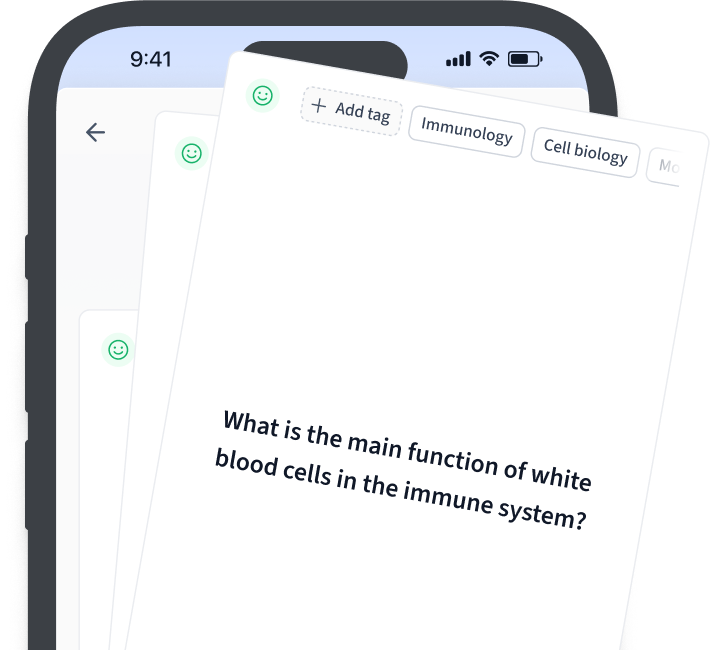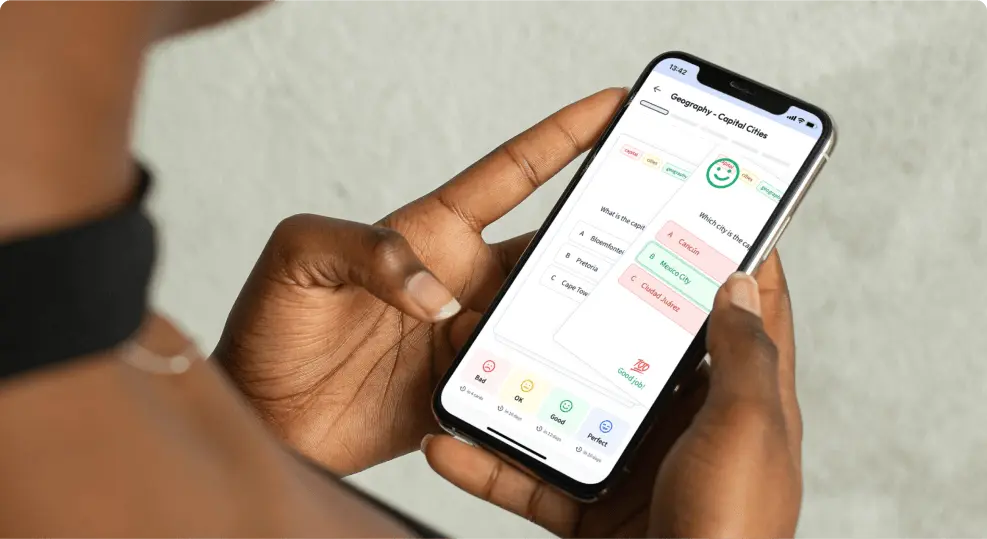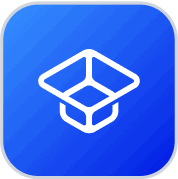Alors comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble ! Pour cela, nous différencierons les marchés par leur degré de concurrence. On s'attardera ensuite sur le modèle de concurrence pure et parfaite.
Car même si ce modèle théorique ne reflète pas la réalité, il permet de comprendre les mécanismes de l'offre et de la demande.
Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ?
Le marché concurrentiel est un lieu, réel ou fictif, où va se rencontrer l'offre et la demande de biens ou de services. L'offreur (ou producteur) cherche à maximiser son profit ; le demandeur (ou consommateur) cherche à obtenir le meilleur prix. L'échange donne souvent lieu à une contrepartie en monnaie.
Ainsi, comment un marché concurrentiel fonctionne-il ? Pour le comprendre, il faut déjà assimiler le fait qu'un marché concurrentiel se doit de fixer des règles pour le bon fonctionnement des échanges. C'est pourquoi on considère aussi le marché comme une institution :
Une institution coordonne et encadre les interactions par des usages, des règles, des conventions et des lois.
Il est important de spécifier que l'on peut classer les marchés en fonction de leur objet d'échange. Voici comment les économistes les différencient :
- Le marché des biens matériels et services (production économique) ;
- Le marché du travail (offre du travail) ;
- Le marché des capitaux (monnaies, obligations, actions boursières).
Le marché des capitaux, ou plus communément la Bourse, est un marché fictif, où les entreprises obtiennent des financements grâce à la vente d’actions, d’obligations ou encore de billets de trésorerie.
Les différents types de marchés
Nous avons vu qu'il était possible de classer les marchés selon leur objet d'échange. Nous allons maintenant découvrir les différents types de marché. En effet, il est possible de différencier les marchés selon leur degré de concurrence (si celle-ci est plus ou moins présente). On se retrouve alors face à trois types de marchés, que nous qualifions d'imparfaitement concurrentiels : le monopole, l'oligopole et la concurrence monopolistique.
Monopole, oligopole et concurrence
Monopole, oligopole et concurrence monopolistique sont trois types de marchés imparfaitement concurrentiels. Sur ces structures de marché, les offreurs sont faiseurs de prix.
Si ces trois marchés présentent un point commun en étant imparfaitement concurrentiels, ils sont néanmoins différents par nature. Regardons maintenant la distinction :
Le monopole
En situation de monopole, aucune concurrence n'existe. Il s'agit d'une situation de marché où un seul offreur répond à toute la demande. Il est donc faiseur de prix (price maker). Le producteur peut augmenter ses prix autant qu'il veut, car il est le seul à répondre à un besoin. Les consommateurs devront alors payer le prix ou se passer du produit/ service.
Durant 83 ans en France, la SNCF était en situation de monopole sur le transport ferroviaire intérieur.
L'oligopole
Ici, il y aura peu de concurrence. Quelques offreurs seulement répondent à la demande des consommateurs. En théorie, cela laisse supposer de la concurrence. Mais, en réalité, le risque d'entente sur les prix entre les offreurs est élevé. Ils se partagent le marché, et les consommateurs vont quand même payer plus cher. Ces secteurs ont peu de chances de voir arriver d'autres acteurs sur leur marché.
En France, les acteurs de la téléphonie mobile sont en situation d'oligopole. Bouygues Telecom, SFR, Orange et Free se partagent la demande.
Certains pays interdisent toute situation de monopole ou d'oligopole. D'autres vont préférer imposer des législations pour limiter leurs pouvoirs.
La concurrence monopolistique
Attention à ne pas confondre avec le monopole! Je sais cela sonne presque pareil mais je vais t'expliquer la différence. Ce marché va présenter une forte concurrence, et il n'y aura aucune barrières à l'entrée pour les nouvelles entreprises. Chaque entreprise dispose néanmoins d'un monopole avec son produit, différent de celui de la concurrence.
La concurrence monopolistique exemple
La concurrence monopolistique : exemple de tous les jours au supermarché. Lorsque tu fais tes courses et que tu choisis une marque de gel douche plutôt qu'une autre.
En concurrence monopolistique, les entreprises disposent parfois d'un monopole avec un produit ou service spécifique, qui se démarque de la concurrence. C'est en obtenant un monopole sur une offre qu'elles pourront augmenter les prix. Pour se différencier, les industries vont user de stratégies marketing et publicitaires.
Pour bien comprendre le fonctionnement de ces marchés imparfaitement concurrentiels, il faut étudier leur modèle de référence : la concurrence pure et parfaite.
Concurrence pure et parfaite
La concurrence pure et parfaite est une théorie néoclassique hypothétique développée au XIXᵉ siècle. Elle sert de référence au marché en présentant 5 conditions à remplir pour atteindre l'équilibre. Ces conditions sont l'atomicité du marché, l'homogénéité des produits, la fluidité, la transparence et la libre circulation des facteurs de production.
Il faut bien comprendre que le marché de concurrence pure et parfaite est théorique. Il est difficile de trouver des marchés qui répondent aux 5 conditions énoncées. Ainsi, lorsqu'un marché ne répond pas à l'une des conditions, on se trouve en situation de marché imparfaitement concurrentiel, comme le monopole et l'oligopole que nous avons vu plus haut. Mais regardons plus en détail à quoi correspondent ces conditions.
L'atomicité du marché
L'atomicité du marché est l'une des conditions principale de la concurrence pure et parfaite. Cela signifie que l'offre (vendeurs) ou la demande (acheteurs) sur le marché doit être suffisamment nombreuse pour qu'aucun acteur ne puisse à lui seul exercer une influence.
L'atomicité du marché permet ainsi un équilibre de marché. Aucune décision individuelle ne peut avoir d'effets sur les autres acteurs car les offreurs ou demandeurs sont trop petits par rapport à la taille du marché concerné.
L'homogénéité des produits
L'homogénéité des produits est l'une des conditions de la concurrence pure et parfaite. Elle signifie que la différence entre les produits ne doit porter que sur le prix, pas la qualité.
Avec une homogénéité des produits, les consommateurs ne peuvent pas faire de distinctions lors de l'achat. Les produits sont de même nature, utilité, et présentent les mêmes attributs physiques. Ainsi, un produit homogène est un substitut parfait, car ses caractéristiques vont satisfaire les besoins d'un consommateur de la même manière qu'un autre produit le ferait.
Pour retenir tout cela plus facilement, nous allons mettre à ta disposition un tableau recensant les 5 conditions de la concurrence pure et parfaite.
Quelles sont les conditions de la concurrence pure et parfaite ?
Conditions de la concurrence pure et parfaite |
Atomicité du marché. L'offre (vendeur) ou la demande (acheteur) sur le marché doit être suffisamment nombreuse pour qu'aucun acteur ne puisse à lui seul exercer une influence. |
Homogénéité des produits. La différence entre les produits ne doit porter que sur le prix, pas la qualité. |
Pas de barrières à l'entrée et à la sortie du marché. Tout nouvel offreur peut entrer ou sortir sans difficulté d'un marché. |
La transparence du marché. Les informations, notamment sur les prix, sont connues de tous, en temps réel et sans coûts. |
La mobilité des facteurs de production (travail et capital). Si le marché est affecté, un producteur doit être en mesure de s'adapter facilement. |
Tu as maintenant une idée plus claire de quelles sont les conditions de la concurrence pure et parfaite. Afin de mieux la conceptualiser, regardons ensemble un exemple de marché qui présenterait toutes ces caractéristiques.
Exemples de concurrence pure et parfaite
Concurrence pure et parfaite : exemple du marché des produits agricoles. Les céréales sont négociées à la bourse de commerce.
Le marché des produits agricoles repose sur le même principe que le marché boursier, mais ici l'échange concerne des biens tangibles. Ainsi, les marchés de matières premières sont un exemple proche de la concurrence pure et parfaite. Pourquoi ? Parce qu'ils répondent à toutes les conditions :
- Le nombre d'offreurs et de demandeurs est très important.
- On peut supposer que la qualité du produit est quasiment la même pour chaque producteur.
- Tout le monde est "preneur de prix". Aucun producteur n'a de pouvoir de marché pour fixer un prix différent.
Pour conclure, le marché de concurrence pure et parfaite va essayer de normaliser les produits. Cela veut dire que tous les produits doivent se ressembler et proposer les mêmes fonctionnalités. Ceci permet d'atteindre un meilleur équilibre concurrentiel. Bien que cette situation de concurrence pure et parfaite soit rare, elle permet de rendre compte du mécanisme de l'offre et de la demande.
Déterminer le prix sur un marché concurrentiel
Nous restons toujours sur un modèle de concurrence pure et parfaite. Ici, l'établissement d'un prix d'équilibre va se jouer en fonction de l'offre et la demande. Après la fixation du prix d'équilibre, les quantités demandées et offertes sur le marché seront ajustées. On parle alors de quantité d'équilibre.
Nous étudierons plus en détail l'offre et la demande dans une prochaine explication StudySmarter. Mais, regardons tout de même ce que cela implique sur un marché concurrentiel.
Offre et demande
La loi de la demande affirme que plus le prix d'un bien est élevé, plus la quantité que les consommateurs souhaitent acheter est faible.
La loi de l'offre stipule que plus le prix d'un bien est élevé, plus les producteurs voudront en fournir.
Peu importe l'objet de l'échange, c'est la relation entre l'offre et la demande, et donc entre un producteur et son consommateur qui va compter. C'est cette variable qui va déterminer le prix et la quantité produite, permettant ainsi au marché d'exister.
Pour schématiser ce dont je te parle, nous allons voir les graphiques qui représentent la loi de l'offre et la demande.
 Fig 1 - La loi de la demande, représentation graphique
Fig 1 - La loi de la demande, représentation graphique
On va représenter la demande par une droite décroissante. La demande pour un bien est logiquement une fonction décroissante de son prix. On peut constater sur le graphique que plus le prix sera haut, plus la quantité demandée sera faible.
 Fig 2 - La loi de l'offre, représentation graphique
Fig 2 - La loi de l'offre, représentation graphique
Au contraire, l'offre d'un bien est une fonction croissante du prix. Cela signifie que plus le prix est élevé, plus le producteur a intérêt d'augmenter le volume produit.
Alors maintenant ce qui nous intéresse, c'est de voir la façon dont le prix est fixé selon l'offre et la demande. Et, ceci toujours dans l'hypothèse d'une concurrence pure et parfaite.
Le prix d'équilibre
Graphiquement, on va représenter le prix d'équilibre au point d'intersection des droites d'offre et de demande.
 Fig 3 - représentation graphique du prix d'équilibre
Fig 3 - représentation graphique du prix d'équilibre
Lecture: Pe représente le prix d'équilibre, et Qe la quantité d'équilibre.
Selon le graphique ci-dessus, au point d'équilibre, tous les consommateurs qui acceptent de payer au prix d'équilibre le trouve. Réciproquement, tous les producteurs qui offrent au prix trouvent preneurs pour leur production.
Le prix du marché en concurrence pure et parfaite est donc déterminé par la rencontre entre la courbe d'offre et de demande. Tu peux découvrir ceci plus en détail sur notre résumé de cours de l'offre et la demande.
Surplus consommateur et producteur
Le surplus consommateur et producteur caractérise les gains à l'échange sur un marché en équilibre. Le surplus du consommateur correspond à l'écart entre le prix payé pour l'obtention d'un bien et le prix maximum qu'il était prêt à payer pour ce même bien. Il en est de même pour le surplus du producteur. On trouve un prix en dessous duquel il ne souhaite pas vendre.
Le surplus du consommateur
Un consommateur va acheter un bien ou un service lorsque son utilité est plus importante que son coût. On appelle le coût d'acquisition le montant maximal que le consommateur est prêt à payer. Alors qu'est-ce que le surplus du consommateur ? Eh bien, il s'agit de l'écart entre le coût d'acquisition et le prix d'équilibre réel effectivement payé. Complexe ? Je te laisse regarder le graphique juste en dessous, ça devrait être plus clair.
Le prix d'équilibre ou réel d'une paire de baskets est de 150 euros. Le consommateur avait un coût d'acquisition maximal de 200 euros. Le surplus du consommateur est de 50 euros.
 Fig 4 - Surplus du consommateur
Fig 4 - Surplus du consommateur
Le surplus du producteur
Sur un marché concurrentiel, le producteur peut choisir de baisser son prix par rapport au prix d'équilibre. Le surplus du producteur est représenté par l'écart entre le prix d'équilibre et celui auquel le producteur était prêt à vendre. Allez, un petit graphique pour la route !
 Fig 5 - Le surplus du producteur
Fig 5 - Le surplus du producteur
Une paire de baskets est à 150 euros. Le producteur était prêt à la vendre 130 euros. Le surplus du producteur est alors de 20 euros.
Pour conclure, le surplus total (en additionnant le surplus du consommateur et du producteur) est maximisé sur un marché en concurrence pure et parfaite. En revanche, nous allons voir dans une prochaine explication que les effets d'une taxe forfaitaire peuvent influencer le prix d'équilibre. Cela aura un impact sur les gains du consommateur ou du producteur, en fonction des cas.
Marché concurrentiel - Points à retenir
- Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il? Le marché est un lieu, réel ou fictif, où vont se rencontrer l'offre et la demande de biens ou de services.
- Il existe plusieurs degrés de concurrence dans un marché concurrentiel : le monopole, l'oligopole, la concurrence monopolistique, le marché concurrentiel.
- Le marché concurrentiel est en concurrence pure et parfaite. Il est rare dans la réalité mais sert de référence au marché.
- La notion de surplus caractérise les gains à l'échange sur un marché en équilibre, et donc en situation optimale.
- L'établissement d'un prix d'équilibre va se jouer en fonction de l'offre et la demande.
- La satisfaction du producteur et du consommateur est maximisée sur un marché à l'équilibre.