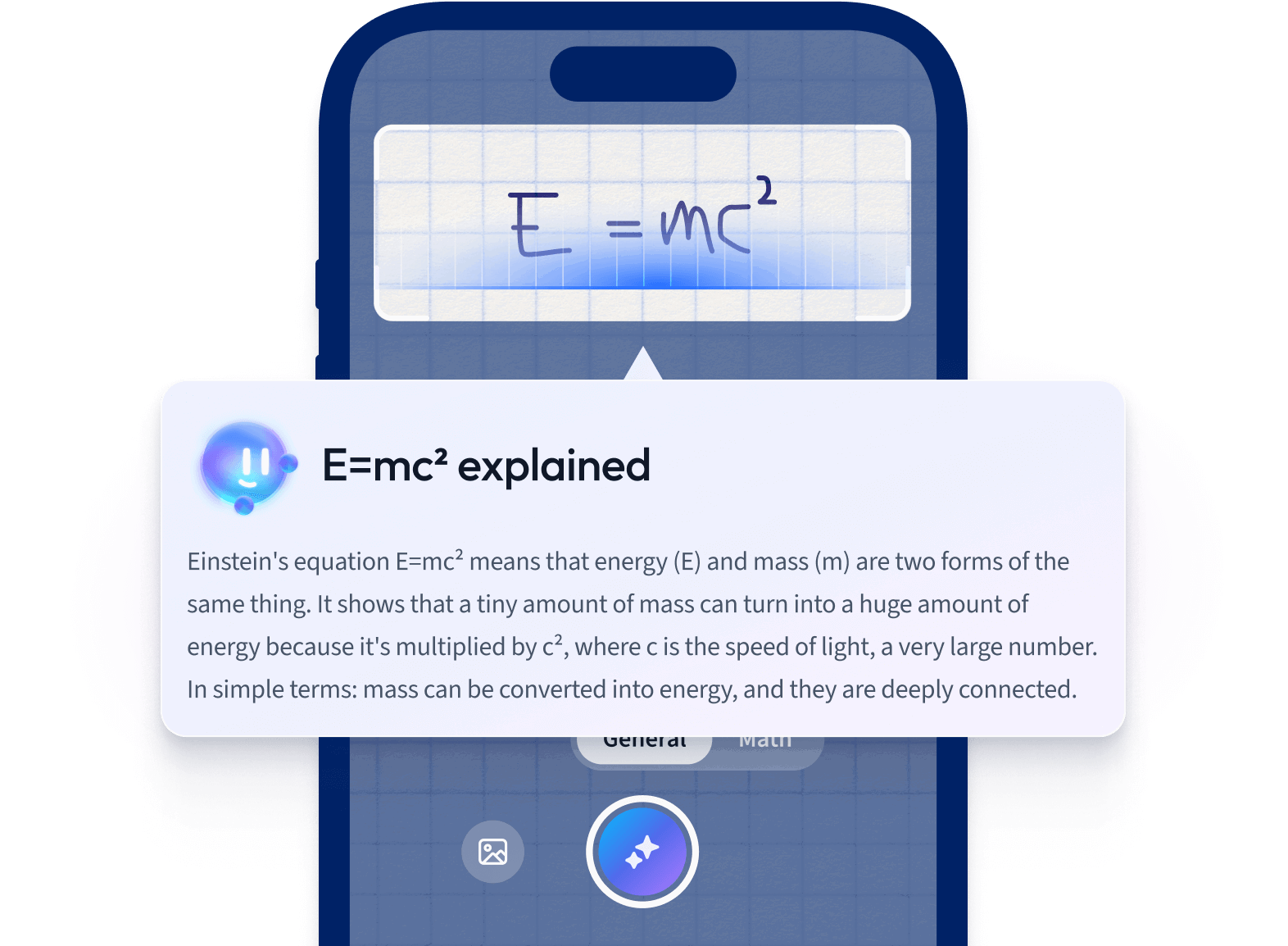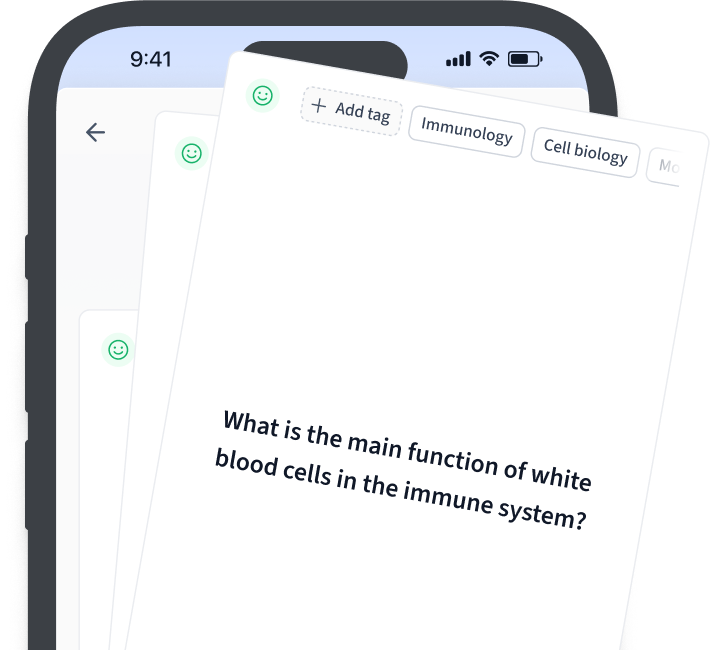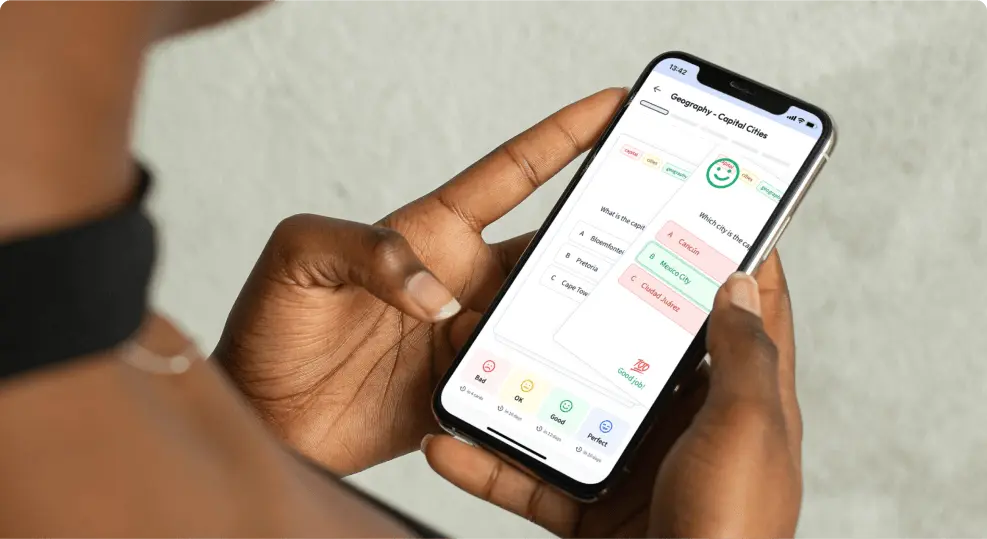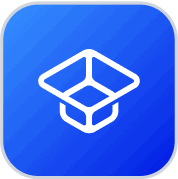Après l'insurrection de la Commune, le monarchiste Patrice de Mac Mahon et le républicain Léon Gambetta s'affrontent. Le projet républicain se met lentement en place. Des lois essentielles sont votées, comme celles sur l'éducation de Jules Ferry, la loi d'association de 1901 et la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État. Entre réformes, crises et colonisations, la Troisième République traverse la Belle Époque et marque l'entrée de la France dans le XXe siècle.
- Dans cet article, tu découvriras ce qu'était la Commune et comment elle a été réprimée dans le sang par Adolphe Thiers.
- Tu pourras lire un résumé du début de la Troisième République, avec la lutte entre Patrice de Mac Mahon et Léon Gambetta et les lois constitutionnelles de 1875.
- Tu trouveras ensuite un tableau récapitulant les présidents de la Troisième République.
- On étudiera aussi les premières réformes du régime, avec les lois de Jules Ferry, la loi d'association de 1901 et la loi de 1905.
- Tu auras également un aperçu de la Belle Époque.
- Puis, on abordera les crises qui ébranlent le pays, notamment l'affaire Dreyfus, le mouvement du général Boulanger et le Front populaire.
- Enfin, tu pourras en savoir plus sur la colonisation opérée par la Troisième République.
Qu'est-ce que la Commune ?
La Commune de Paris est un gouvernement révolutionnaire qui dirige la capitale française du 18 mars 1871 au 28 mai 1871.
 Image 1. Barricade des communards
Image 1. Barricade des communards
Après la capitulation de Napoléon III à la suite de sa défaite à Sedan, la Troisième République est proclamée le 4 septembre 1870. Le nouveau Gouvernement de la Défense nationale a pour mission de continuer la guerre, mais une majorité monarchique s'installe et l'armistice est finalement signé en janvier 1871.
La population parisienne, majoritairement ouvrière, y voit une trahison et prend les armes ; une situation qui va se répandre dans les autres villes françaises telle une traînée de poudre. L'insurrection s'organise et devient la Commune de Paris.
Le 21 mai, Adolphe Thiers, chef du pouvoir exécutif légitime et réfugié à Versailles, envoie l'armée sur Paris. C'est le début de la semaine sanglante, sept jours de combats, de massacres et d'exécutions. Le 28 mai, la Commune de Paris tombe.
On estime entre 10 000 et 20 000 le nombre de Communards, ou suspectés tels, tués pendant la semaine sanglante, contre 900 versaillais.
Des milliers de personnes affiliées à la Commune sont déportées. Elles sont graciées en 1880 par le Parlement républicain.
Début de la Troisième République : résumé
Au début, la Troisième République est supposée être provisoire. Certaines personnalités politiques, comme Adolphe Thiers ou Mac Mahon, veulent en effet le retour de la monarchie en France. D'autres voix, comme celle de Léon Gambetta, s'élèvent pour mettre en place un modèle républicain durable. Les lois constitutionnelles de 1875 instaurent finalement le régime parlementaire de la Troisième République.
Patrice de Mac Mahon
Succédant à Adolphe Thiers en tant que Président en 1873, le maréchal Mac Mahon est un monarchiste. Il nomme deux fois le duc de Broglie président du Conseil, entendant rétablir l'ordre moral. Il rencontre une vive opposition de la Chambre des députés à partir de 1876, donnant aux Républicains la majorité. Il démissionne en 1879.
Léon Gambetta
C'est Léon Gambetta, surnommé le père fondateur de la République, qui proclame la Troisième République le 4 septembre 1870.
Le peuple a devancé la chambre qui hésitait.
Pour sauver la Patrie en danger, il a demandé la République.
Il a mis ses représentants non au pouvoir, mais au péril.
La République a vaincu l’invasion en 1792 ; la République est proclamée.
La révolution est faite au nom du droit, du salut public.
Citoyens, veillez sur la cité qui vous est confiée ; demain vous serez, avec l’armée, les vengeurs de la Patrie.1
Figure de l'opposition républicaine, il est député sous Thiers et Mac Mahon, avant de faire partie du gouvernement en 1881. Il s'engage pour des mesures républicaines comme les lois constitutionnelles de 1875. Il meurt prématurément fin 1882.
Lois constitutionnelles de 1875
En janvier 1875 est voté l'amendement Wallon, promulguant l'élection d'un Président de la République par l'Assemblée nationale, pour sept ans. Quelques mois plus tard sont votées trois lois constitutionnelles, surnommées « Constitution de 1875 ». La Troisième République, régime parlementaire, est instaurée.
Ce régime parlementaire est, dans le texte, dualiste : le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale et le chef de l'État.
À partir de 1876, les républicains accèdent à la tête des organes institutionnels et le rôle du Président s'affaiblit. Le régime perd ce caractère dualiste : le gouvernement devient progressivement responsable uniquement devant l'Assemblée nationale.
Présidents de la Troisième République
| Date | Président | Bord politique |
| 1871–1873 | Adolphe Thiers | Républicain conservateur |
| 1873–1879 | Patrice de Mac Mahon | Légitimiste (monarchiste) |
| 1879–1887 | Jules Grévy | Républicain modéré |
| 1887–1894 | Sadi Carnot | Républicain modéré |
| 1894–1895 | Jean Casimir-Perier | Républicain modéré |
| 1895–1899 | Félix Faure | Républicain modéré |
| 1899–1906 | Émile Loubet | Centre-droit |
| 1906–1913 | Armand Fallières | Républicain modéré, centre-droit |
| 1913–1920 | Raymond Poincaré | Centre-droit |
| 1920 | Paul Deschanel | Républicain modéré, centre-droit |
| 1920–1924 | Alexandre Millerand | Centriste |
| 1924–1931 | Gaston Doumergue | Républicain radical, centre-gauche |
| 1931–1932 | Paul Doumer | Indépendant, centre-droit |
| 1932–1940 | Albert Lebrun | Républicain modéré, centre-droit |
Trois présidents de la Troisième République meurent en exercice :
- Sadi Carnot est assassiné par un anarchiste italien, Caserino.
- Félix Faure meurt d'un accident vasculaire cérébral à l'Élysée.
- Paul Doumer est assassiné par un émigré russe, Gorgulov.
Premières réformes de la Troisième République
La Troisième République établit certains principes républicains, encore reconnus de nos jours, comme l'école gratuite, laïque et obligatoire, la liberté d'association ou encore la séparation de l'Église et de l'État.
Lois de Jules Ferry
Entre 1881 et 1886, Jules Ferry fait passer plusieurs lois scolaires, qui entérinent trois principes républicains de l'enseignement. L'école primaire devient obligatoire, tandis que l'ensemble de l'école publique est désormais gratuite et laïque, c'est-à-dire sans instruction religieuse.
Ces réformes concrétisent un mouvement de scolarisation massive entamé avant la Troisième République.
Ainsi, en 1833, la loi Guizot impose aux communes d’avoir une école primaire pour garçons, tandis que la loi Falloux de 1850 leur impose une école primaire pour filles. Ces dernières accèdent à l'enseignement secondaire en 1880, avec la loi Camille Sée.
1901 : Loi sur la liberté d'association
En France la liberté d'association est votée sous la Troisième République. En effet, le 1ᵉʳ juillet 1901, Pierre Waldeck-Rousseau fait adopter la loi sur la liberté d'association, abrogeant la loi Le Chapelier de 1854. Elle fonde le principe, encore en vigueur, de la liberté qu'ont plusieurs individus de s'associer, dans un but commun désintéressé (à but non-lucratif).
Loi de 1905
La loi de 1905 est présentée par Aristide Briand et promulguée le 9 décembre. Elle instaure la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté pour chaque individu de choisir son système de valeurs. Elle établit aussi la séparation de l'Église et de l'État et met fin à la subvention des cultes : la République française est désormais neutre vis-à-vis des religions. Cette loi s'inscrit dans le mouvement anticlérical qui domine au sein des républicains.
L'anticléricalisme désigne l'opposition aux ecclésiastiques d'une organisation religieuse spécifique. Un ecclésiastique est une personne ayant une position d'autorité dans une communauté religieuse, comme les évêques et les prêtres dans l'Église catholique, les imams et mollahs dans les sociétés musulmanes et les rabbins dans les communautés juives.
La Belle Époque
La Belle Époque, terme apparu après la Première Guerre mondiale, désigne une période de paix et de prospérité, pour certains Français, des années 1880 jusqu'en 1914.
La France connaît la seconde révolution industrielle, des progrès technologiques, sociaux et économiques et l'affirmation du mouvement ouvrier, qui s'organise en partis politiques, comme le Parti ouvrier ou la SFIO.
 Image 2. Exposition universelle de 1900 à Paris
Image 2. Exposition universelle de 1900 à Paris
Les crises de la Troisième République
La mise en œuvre du projet républicain ne se fait pas sans difficulté et la Troisième République connaît plusieurs crises, dont l'affaire Dreyfus et le mouvement boulangiste, qui révèlent de forts courants antisémites et nationalistes.
L'affaire Dreyfus
En 1894, l'officier Alfred Dreyfus, d'origine alsacienne et de confession juive, est accusé à tort et condamné pour espionnage en faveur de l'Allemagne. Le vrai coupable, le commandant Esterhazy, est découvert deux ans plus tard, mais l'armée continue de le protéger et refuse un nouveau procès.
L'opinion publique se divise entre anti-dreyfusards et dreyfusards, parmi lesquels l'écrivain Émile Zola, qui publie l'article « J'accuse » dans l'Aurore en 1898. Après plus de quatre ans au bagne en Guyane, Dreyfus est finalement gracié en 1899 par le président Loubet puis innocenté en 1906 par la Cour de cassation.
 Image 3. Alfred Dreyfus au bagne en 1898
Image 3. Alfred Dreyfus au bagne en 1898
Qui est le général Boulanger ?
Surnommé le « général Revanche », le général Boulanger est un militaire français qui devient ministre de la Guerre en 1886. Inquiétant les républicains par son discours belliqueux, il est écarté du gouvernement en mai 1887. Cette éviction entraîne la naissance du mouvement boulangiste, antirépublicain et germanophobe.
Le général, candidat dans de nombreux départements, reçoit notamment le soutien des bonapartistes et des monarchistes. Ses députés se font élire et le mouvement prend de l'essor jusqu'en janvier 1889 où il est élu à Paris. Les républicains réagissent en le menaçant de lancer un mandat d'arrêt. Le général s'exile en Belgique où il se suicide deux ans plus tard.
Le Front populaire
La crise économique des années 1930 frappe fort la France, déjà affaiblie par la Première Guerre mondiale. Le mouvement d'extrême droite prend de l'ampleur, atteignant son paroxysme lors des émeutes antiparlementaires du 6 février 1934.
En réaction, les partis de gauche s'organisent : le Front populaire est formé. Il gagne les élections législatives de mai 1936 et Léon Blum, socialiste, devient président du Conseil.
C'est sous sa présidence que les Accords de Matignon sont signés, en juin 1936. Ils mettent en place les conventions collectives, reconnaissent la liberté syndicale et relèvent les salaires. D'autres réformes instaurent deux semaines de congés payés et la semaine de 40 heures.
Pour cause de luttes internes et face à la montée de la droite, le Front populaire chute en 1938. La Seconde Guerre mondiale éclate un an après et en 1940, les pleins pouvoirs sont votés à Philippe Pétain, signant la fin de la Troisième République.
La colonisation sous la Troisième République
La Troisième République, malgré quelques oppositions, adopte une politique coloniale. Elle envahit une partie de l'Afrique et instaure une domination française autoritaire sur les territoires occupés.
Conférence de Berlin de 1884-1885
Dans les années 1880, la majorité du continent africain est sous contrôle de la population locale. La présence européenne est encore sporadique, mais le Congo est source de tensions entre la Belgique, la France, le Royaume-Uni et le Portugal. Pour régler ce différend, la conférence de Berlin est organisée, réunissant les dirigeants impériaux européens, sans représentation africaine.
Les discussions dépassent la question congolaise. Les puissances européennes débattent de la liberté de navigation et de commerce et du monopole commercial en Afrique. C'est le début du partage de l'Afrique, une course à l'occupation européenne des territoires africains.
 Image 4. Caricature du partage de l'Afrique par les dirigeants européens
Image 4. Caricature du partage de l'Afrique par les dirigeants européens
Code de l'indigénat
En 1881, le code de l'indigénat, en réalité une suite de décrets, entérine en Algérie la domination de l'administration française. Il différencie citoyens français et sujets français. La population algérienne est privée d'une partie de sa liberté et de ses droits politiques : travaux forcés, couvre-feu, contrôle des déplacements hors de la commune, réquisition d'animaux, etc. L'infraction à ces règles répressives est lourdement punie, souvent sans procès.
À partir de 1887, ce code de l'indigénat est étendu à l'ensemble des colonies françaises. Il est aboli en 1946 pour la majorité des colonies, sauf l'Algérie, qui en subit certains aspects jusqu'à son indépendance, en 1962.
Troisième République - Points clés
- La Troisième République est le modèle républicain le plus stable à ce jour, de 1870 à 1940. C'est un régime parlementaire.
- La Commune est un mouvement insurrectionnel de 1871. Elle est réprimée par les versaillais d'Adolphe Thiers lors de la semaine sanglante.
- Certaines lois essentielles sont votées sous la Troisième République. Tu peux retenir les lois scolaires de Ferry, la loi de 1901 sur le droit d'association et la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État.
- La Troisième République traverse plusieurs crises, dont l'affaire Dreyfus et la crise boulangiste.
- Dans l'entre-deux-guerres, le Front populaire permet plusieurs avancées sociales dans le domaine du travail.
- Les républicains adoptent une politique coloniale de conquête. Une des représentations de cette colonisation est le code de l'indigénat.
Références
- Léon Gambetta, Hôtel de ville de Paris, le 4 septembre 1870. Signé : Emmanuel Arago, Adolphe Crémieux, Pierre-Frédéric Dorian, Jules Favre, Jules Ferry, Antoine-Léonce Guyot-Montpayroux, Léon Gambetta, Louis-Antoine Garnier-Pagès, Joseph-Pierre Magnin, Francisque Ordinaire, Pierre-Albert Tachard, Eugène Pelletan, Ernest Picard, Jules Simon. MOREL Benjamin, « 1870-2020 : Cent cinquante ans de la proclamation de la République – Suite », Site internet Revue Politique (17 septembre 2020 - Consulté le 11 novembre 2022)
- Image 4. Caricature « Découpage de l’Afrique à la conférence de Berlin - À chacun sa part, si l'on est bien sage. » Journal L'Illustration. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IMGCDB82_-_Caricatura_sobre_conferencia_de_Berl%C3%ADn,_1885.jpg