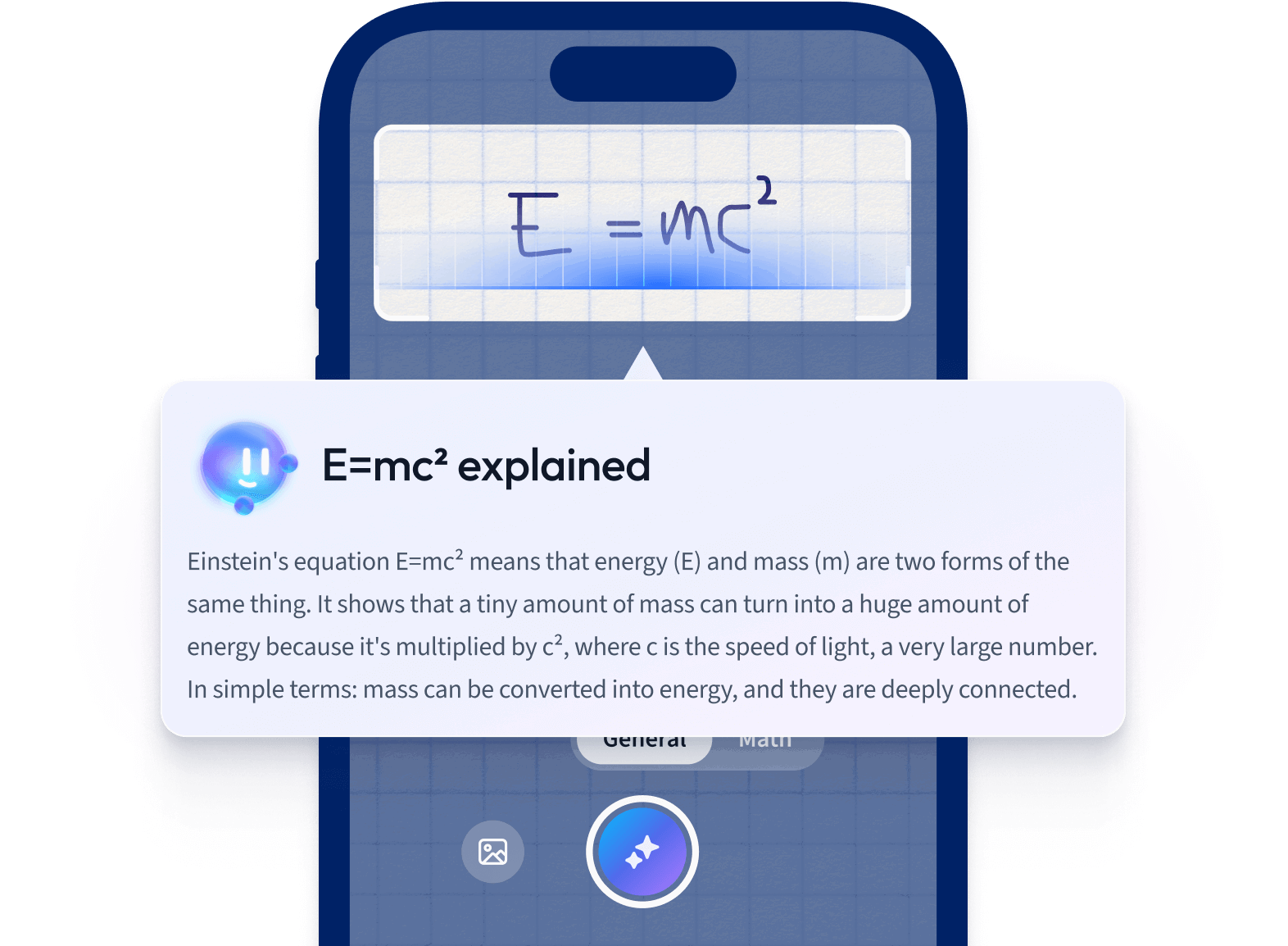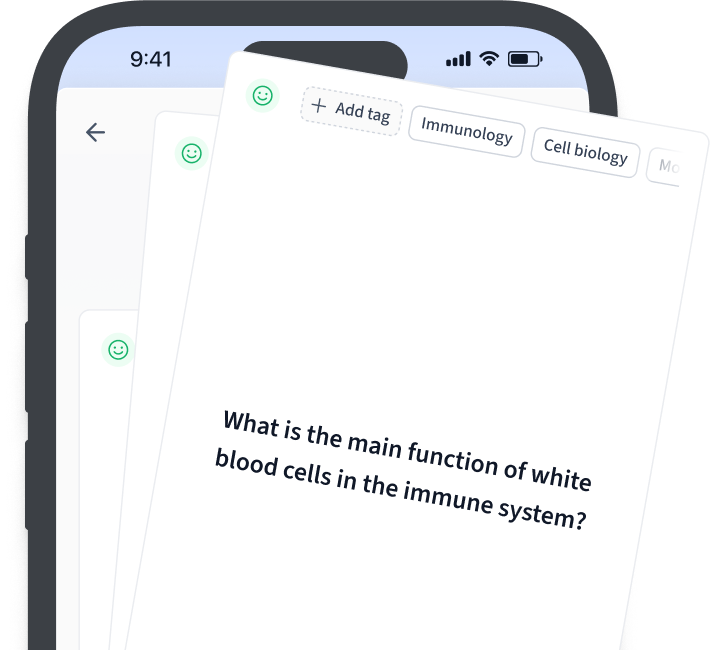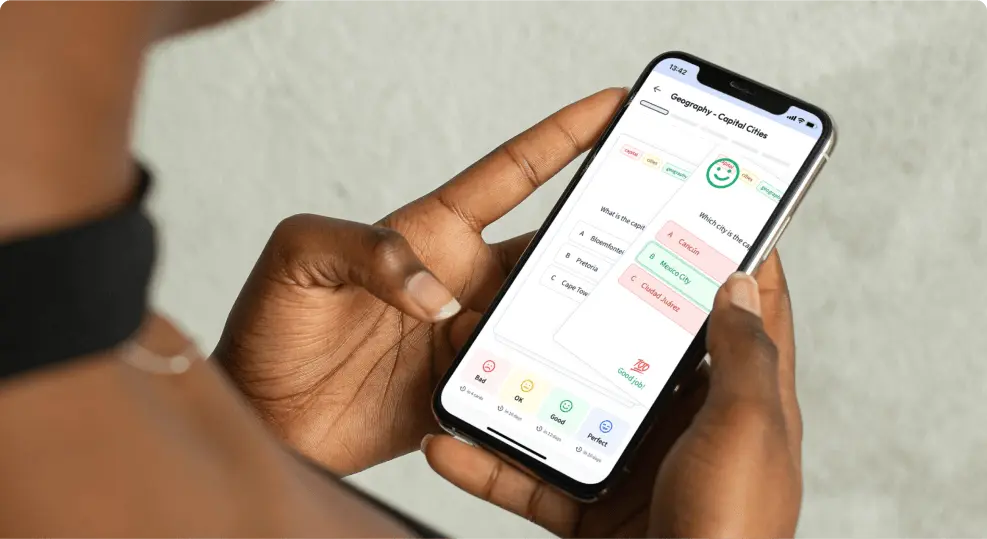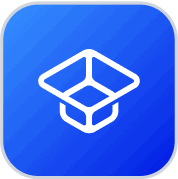L'indépendance de l'Algérie est un long combat pour le nationalisme et la décolonisation. Le FLN souhaite la souveraineté algérienne et le départ des Européens installés depuis des années, qu'on surnomme plus tard les pieds-noirs. L'armée française pratique une répression violente et engage des milliers d'Algériens, les Harkis, dans ses rangs. Le général de Gaulle est rappelé au pouvoir pour résoudre la situation, tandis que le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) n'est pas reconnu par les autorités françaises. C'est la ratification des accords d'Évian le 18 mars 1962 qui mène à l'indépendance de l'Algérie.
- Tu découvriras d'abord ce qui cause la guerre d'indépendance algérienne.
- Tu auras ensuite un résumé des principaux groupes impliqués dans la guerre : FLN, armée française, Harkis, pieds-noirs et OAS.
- Une rapide chronologie de la guerre te présentera les moments marquants du conflit.
- Puis, on abordera les accords d'Évian et les entités politiques de chaque côté.
- Enfin, tu en sauras plus sur les conséquences immédiates de l'indépendance de l'Algérie.
Quelles sont les causes de la guerre d'Algérie (1954–1962) ?
La guerre d'Algérie, ou guerre d'indépendance algérienne, est causée par deux évènements :
La conquête de l'Algérie
La France envahit l'Algérie en 1830. Cette invasion est incroyablement violente et comprend le massacre, le viol et la torture des Algériens. Cette dernière entraîne la mort de plus d'un tiers de la population algérienne.
En 1848, l'Algérie est un département français. Les départements et régions d'outre-mer ont en théorie le même statut que ceux de la métropole. En réalité, beaucoup sont traités comme des colonies, avec des droits très limités.
La colonisation est très bénéfique et profite économiquement à la France. Plus d'un million d'Européens s'installent en Algérie, représentant 10 % de la population. Ces Européens, provenant de France, d'Espagne, d'Italie et de Malte, sont issus de la classe ouvrière, mais bénéficient d'un statut supérieur aux Algériens d'origine. Cette disparité socio-économique entraîne de la méfiance entre les deux groupes.
Le nationalisme algérien
Dans les années 1920, certains intellectuels algériens commencent à exprimer un désir d'indépendance ou, tout du moins, d'autonomie et de souveraineté. Cependant, il apparaît rapidement que le droit à l'auto-détermination semble être un concept réservé aux peuples privilégiés d'Europe. Les colons résistent aussi à l'idée que des Algériens d'origine participent à la vie démocratique, n'ayant aucunement l'intention de laisser la population colonisée obtenir un statut égal au leur.
Le 8 mai 1945, alors que la France célèbre la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale, l'Algérie s'attend à ce que la Libération lui parvienne aussi. Lorsqu'ils comprennent que ce n'est pas le cas, des Algériens organisent une manifestation dans la ville de Sétif, qui tourne au massacre. Plus de 100 pieds-noirs sont tués et les soldats français, sous les ordres de De Gaulle, ôtent la vie à une ou plusieurs dizaines d'Algériens. Le massacre de Sétif choque l'opinion algérienne et radicalise le mouvement d'indépendance. Une nouvelle génération de figures réclamant l'indépendance émerge.
Cette guerre est une guerre majeure de la période anticoloniale. Bien que les personnes combattant du côté algérien ont une variété de différences idéologiques, le nationalisme algérien sert à unifier ceux s'opposant à la France.
Le nationalisme anticolonial est le rejet de la domination d'une puissance coloniale et la recherche d'une indépendance et d'une souveraineté libre de toute interférence extérieure.
Qui sont les protagonistes de la guerre d'Algérie ?
Les protagonistes de la guerre d'Algérie sont :
le Front de libération nationale (FLN) ;
l'armée française et les Harkis ;
les pieds-noirs ;
l'Organisation de l'armée secrète (OAS).
Cette guerre divise les populations algériennes et françaises.
Le Front de libération nationale (FLN)
Le FLN se bat pour l'indépendance de l'Algérie. Il utilise la guérilla pour combattre la supériorité militaire de la France. Son bras armé est l'Armée de libération nationale (ALN), dont les combattants sont appelés les djounoudi. Plus généralement, on appelle moudjahid toute personne ayant combattu contre la présence coloniale française en Algérie.
Le mot moudjahid fait référence dans l'islam à un combattant pour la foi engagé dans le jihad. Il est aussi utilisé pour désigner les résistants afghans contre l'URSS lors de la guerre d'Afghanistan.
 Image 1. Soldats du FLN, guerre d'Algérie
Image 1. Soldats du FLN, guerre d'Algérie
L'armée française et les Harkis
L'armée française combat le FLN. Elle est à l'origine soutenue par la population française et les colons en Algérie.
Les Harkis sont des soldats locaux employés dans l'armée française pour lutter contre le FLN.
En 2018, l'État français reconnaît l'usage de la torture durant la guerre d'Algérie, après des décennies de démenti. Les troupes françaises pratiquent la torture physique, par suspension, simulacre de noyade, brimades, brûlures ou viol, et la torture psychologique. La Question d'Henri Alleg1, autobiographie censurée à l'époque, témoigne des tortures subies aux mains de l'armée française.
Les pieds-noirs
Les pieds-noirs sont les personnes originaires de France ou d'autres pays européens nées en Algérie à l'époque de la colonisation française. Pendant la guerre d'Algérie, ils soutiennent massivement la domination française et s'opposent au FLN et aux groupes nationalistes algériens. Ils veulent maintenir le statu quo grâce auquel ils jouissent de privilèges socio-économiques. C'est après l'indépendance et leur rapatriement en métropole qu'on les surnomme les pieds-noirs.
L'Organisation de l'armée secrète (OAS)
L'OAS est une organisation paramilitaire française dissidente. Elle organise des attaques terroristes pour lutter contre les indépendantistes. Un de ses slogans est : « L'Algérie est française et le restera ». L'OAS sert souvent les besoins politiques des pieds-noirs.
Résumé de la guerre d'Algérie
1ᵉʳ novembre 1954. Le FLN lance une révolte armée dans toute l'Algérie, réclamant l'indépendance. La France réagit en déployant ses troupes pour contrôler la situation. Cet évènement, parfois surnommé la Toussaint rouge, marque le début de la guerre d'Algérie.
Massacres d'août 1955 dans le Constantinois. Le FLN lance des attaques sur des civils soutenant la colonisation, entraînant la mort de plus 170 personnes à Philippeville. L'armée française et des milices de pieds-noirs ripostent en tuant près de 10 000 Algériens.2
30 septembre 1956. Pour attirer l'attention sur le conflit, le FLN commence à cibler des zones urbaines, dérivant de son approche habituelle. Trois femmes affiliées au FLN posent des bombes dans des endroits publics. La ville éclate dans la violence.
 Image 2. Membres du réseau bombes de la Zone autonome d'Alger
Image 2. Membres du réseau bombes de la Zone autonome d'Alger
Bataille d'Alger, 7 janvier 1957–9 octobre 1957. L'arrivée au pouvoir du général Massu entraîne un mouvement de révolte massif du FLN. Les troupes françaises reçoivent pour ordre de le réprimer « par tous les moyens », y compris la torture. Cette attitude entraîne la fin du soutien international à la France.
Coup d'État du 13 mai 1958. Après l'incapacité de la France à réprimer la révolution, des pieds-noirs prennent le contrôle du gouvernement général à Alger. Soutenus par des officiers de l'armée française, ils demandent le retour de Charles de Gaulle au pouvoir. Ce dernier est institué président du Conseil. Son arrivée est perçue positivement des deux côtés.
16 septembre 1959. De Gaulle déclare que l'autodétermination de l'Algérie est nécessaire. Son annonce choque et inquiète les pieds-noirs.
8 janvier 1961. Référendum en métropole et en Algérie sur l'autodétermination de l'Algérie. 74,99 % des votants se prononcent pour.
Le putsch des généraux, avril 1961. Quatre généraux de l'armée française essayent de renverser de Gaulle en Algérie, dans l'espoir de préserver l'Algérie française.
18 mars 1962. Le GPRA et le gouvernement français signent les accords d'Évian qui instaurent un cessez-le-feu et le principe d'autodétermination. Ils sont approuvés par référendum français à 90,81 % le 1ᵉʳ avril 1962.
Mars–juin 1962. L'OAS organise des attaques terroristes contre des civils, en Algérie et en France. L'OAS et le FLN parviennent éventuellement à un cessez-le-feu.
1ᵉʳ juillet 1962. L'Algérie organise un référendum pour approuver les accords d'Évian. Sur six millions de votes, 99,72 % soutiennent l'indépendance.
5 juillet 1962. Proclamation de l'indépendance de l'Algérie.
La négociation des accords d'Évian
Les accords d'Évian sont signés le 18 mars 1962 après 2 ans de tentatives de négociations et 10 jours de pourparlers à Évian-les-Bains. En principe, ils instaurent un cessez-le-feu et l'organisation de référendums d'autodétermination en France et en Algérie. En réalité, les conflits continuent jusqu'en juin 1962.
Le général de Gaulle
Le général de Gaulle, considéré comme le héros de la Libération, ne participe plus à la vie politique depuis 1946 et la mise en place de la IVᵉ République. Rappelé au pouvoir en juin 1958 après le coup d'État à Alger, il fait rapidement voter la Vᵉ République. La majorité des populations françaises et algériennes ont foi dans sa capacité à résoudre la crise.
Son discours du 4 juin 1958, avec la fameuse phrase « Je vous ai compris ! » donne beaucoup d'espoir aux Français d'Algérie, qui se sentent par la suite trahis lorsqu'il accepte l'autodétermination algérienne.
Il est absent des négociations à Évian : c'est Louis Joxe, ministre des Affaires étrangères qui négocie et signe pour la France.
Le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA)
Le GPRA est le bras politique du FLN et l'organe exécutif du parti politique du Mouvement national algérien. Il est créé en 1958 et est présidé par Ferhat Abbas, puis par Ben Khedda à partir de 1961.
 Image 3. Délégation du GPRA aux accords d'Évian
Image 3. Délégation du GPRA aux accords d'Évian
Le GPRA peine d'abord à faire valoir sa légitimité auprès du gouvernement français, mais est finalement l'interlocuteur des représentants français à Évian. Son vice-président Krim Belkacem signe les accords en son nom. Le GPRA est dissous à l'indépendance de l'Algérie.
Indépendance de l'Algérie et décolonisation
Au lendemain de la guerre, des centaines de milliers de pieds-noirs fuient en France. Cela entraîne la formation d'une grande communauté qui se sent autant en décalage avec l'Algérie qu'avec la France : ils sont nostalgiques de leur foyer algérien.
Les Harkis, eux, sont considérés comme des traîtres par les partisans du FLN et ne bénéficient que d'un faible soutien de l'État français pour un rapatriement en métropole. Des dizaines de milliers meurent en Algérie en quelques mois, malgré une stipulation des accords d'Évian empêchant des représailles. 3
La transition politique et économique est rendue difficile par la rapidité du départ des Européens et les désaccords entre les membres du FLN, seul parti au pouvoir pendant plus de 20 ans. Dans les années 1980, un processus de démocratisation se met en place, avant qu'une guerre civile ne ravage le pays de 1992 à 1999. C'est aujourd'hui une démocratie représentative constitutionnelle.
Sur le plan mondial, l'Algérie devient une des figures de proue du mouvement des non-alignés et de la décolonisation. Les relations politiques avec la France restent complexes jusqu'à de nos jours.
Guerre d'Algérie - Points clés
- La France envahit l'Algérie en 1830. La colonisation est violente et implique le massacre, la torture et le viol de la population algérienne.
- La guerre d'Algérie débute en 1954 et se termine en 1962 par l'indépendance totale de l'Algérie.
- Plusieurs groupes sont impliqués dans la guerre :
- Le Front de libération nationale (FLN), mouvement luttant pour l'indépendance.
- L'armée française, plus les Harkis qu'elle emploie localement, qui s'oppose au FLN.
- Les civils d'origine européenne installés en Algérie et qui souhaitent qu'elle reste française. À leur retour en Europe, on les surnomme les pieds-noirs.
- L'Organisation de l'armée secrète (OAS), un groupe terroriste français luttant contre l'indépendance.
- Les évènements de la bataille d'Alger font perdre à la France le soutien international dont elle dispose.
- Les accords d'Évian signés le 18 mars 1962 entre l'État français et le Gouvernement provisoire de la République algérienne ouvrent la voie à l'indépendance de l'Algérie, proclamée le 5 juillet 1962.
- La prévalence flagrante de la violence et de la torture pendant la guerre d'Algérie en font une des guerres les plus brutales de l'époque post-coloniale.
- L'Algérie devient un symbole de la décolonisation.
Références
- ALLEG, Henri, La Question, Les Éditions de Minuit, Paris, 1958.
- STORA, Benjamin, « Le massacre du 20 août 1955: Récit historique, bilan historiographique », Historical Reflections/Reflections Historiques, Vol. 36, No. 2, Colonial Violence, pp. 97-107, Berghahn Books, 2010.
- GAMRASNI, Mickaël, « Harkis : combien de Harkis... ? » Site Fondation pour la mémoire de la Guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie (2014 - consulté le 13 décembre 2022)
Sujets similaires dans Histoire
Related topics to Après-guerre
Comment tu t'assures que ton contenu est précis et digne de confiance ?
Chez StudySmarter, tu as créé une plateforme d'apprentissage qui sert des millions d'étudiants. Rencontre les personnes qui travaillent dur pour fournir un contenu basé sur des faits et pour veiller à ce qu'il soit vérifié.
Processus de création de contenu :
Lily Hulatt est une spécialiste du contenu numérique avec plus de trois ans d’expérience en stratégie de contenu et en conception de programmes. Elle a obtenu son doctorat en littérature anglaise à l’Université de Durham en 2022, a enseigné au Département d’études anglaises de l’Université de Durham, et a contribué à plusieurs publications. Lily se spécialise en littérature anglaise, langue anglaise, histoire et philosophie.
Fais connaissance avec Lily
Processus de contrôle de la qualité du contenu:
Gabriel Freitas est un ingénieur en intelligence artificielle possédant une solide expérience en développement logiciel, en algorithmes d’apprentissage automatique et en IA générative, notamment dans les applications des grands modèles de langage (LLM). Diplômé en génie électrique de l’Université de São Paulo, il poursuit actuellement une maîtrise en génie informatique à l’Université de Campinas, avec une spécialisation en apprentissage automatique. Gabriel a un solide bagage en ingénierie logicielle et a travaillé sur des projets impliquant la vision par ordinateur, l’IA embarquée et les applications LLM.
Fais connaissance avec Gabriel